Kery james ahhh lala c'est vraiment un rappeur talentueux, depuis mafia cainfry il à toujours sû se différencier des autres par ses lyrics travailler avec minutie, son flow élégant et son discour saillant, je pense que comme artiste il n'y a pas meilleur evolution, il y a un temps pour chaques choses et kery james l'a bien compris, j'espère qu'il continuera dans cette lancée en tout cas moi je l'apprécie grave j'ai etait à un de ses concert à l'elysée et y'a vraiment rien à dire.
Mes titres préférés : Hardcord, 28 décembre, ce A d'avillissant, aprés la mort, cessez le feu, des terres d'afrique, désequilibré... et j'en passe la liste et trop longue je vais finir par citer tous ses titreson attend avec impatience le nouvel album!!!
PEACE
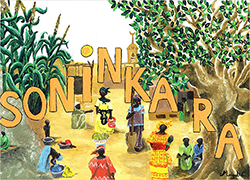
Affichage des résultats 1 à 10 sur 130
Discussion: Kery James
- 15/02/2008, 20h25 #1
 Kery James
Kery James
Le 15 février 2008
Musique, Entretien
Kery James
Le troisième album solo de Kery James sortira le 31 mars. Le rappeur français d’origine haïtienne s’illustre également sur un autre terrain, celui du social.
par Ismael Mohamed Ali
Son association, ACES (Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir), cherche à révolutionner l’image de la banlieue et de ses habitants. Son idée étant celle de montrer que la banlieue est un lieu positif de mixité sociale, solidaire, inter-générationnel et en perpétuel mouvement. A l’image de son dernier clip "Banlieusard", Kery James se raconte.
Key James dans les locaux de l’agence de communication LN SY en proche banlieue parisienne © Ismaïl Mohamed Ali
Haïtien, Guadeloupéen, Caribéen, Français, Africain ; qui êtes-vous ?
Kery James : Je suis avant tout un être humain de la planète terre.
Comment doit-on vous appeler, Alix Mathurin, Kery James ou Ali ?
Kery James : Les trois sont valables. Ce n’est pas le nom qui fait la personne. L’essentiel, c’est ce qu’on est.
Quelle place occupait la musique dans la maison lorsque vous étiez enfant ?
Kery James : Elle n’était pas omniprésente. Je ne suis pas issu d’une famille de mélomanes. Mon père était plus préoccupé par les livres que par les disques. Il aurait souhaité faire des études poussées. Il fondait d’ailleurs beaucoup d’espoirs en moi. S’il en avait eu la capacité, il aurait été, je pense, très loin.
Quel type de rappeur êtes-vous ?
Kery James : A une époque, j’ai été caractérisé comme un rappeur hardcore. Si ce n’est le rappeur « le plus hardcore » parce que je tenais des propos parfois violents. C’était à un moment de ma vie où je ressentais une forme d’injustice sociale envers moi et beaucoup de gens qui me ressemblaient. J’étais jeune. Je n’avais pas assez de recul pour exprimer autrement ce constat qu’avec virulence. Aujourd’hui, j’ai un peu changé. J’ai changé mon discours, mais cela ne veut pas dire que les injustices sociales n’existent plus. Elles sont toujours là. Je me suis rendu compte que nous devions nous prendre en main. On ne peut pas compter uniquement sur les dirigeants du pays et sur le système pour nous sauver. Dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, on n’a pas d’autres choix que de se battre.
De quand date votre premier contact avec le monde du rap ?
Kery James : En Guadeloupe, où je suis né, l’émission « H.I.P H.O.P » passait à la télévision... Mais, c’est à Orly, où le mouvement hip-hop existait déjà, que je me suis éveillé au rap. Il y avait une Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC), où les « grands » écoutaient du son. C’est d’ailleurs dans cette maison de quartier que j’ai découvert la danse et notamment le haprock : la danse du combat. Ce style m’a fasciné et c’est ainsi que je suis rentré dans le mouvement hip-hop en 1989/1990.
Vous faites partie de ces rappeurs qui s’engagent, comme Ekoué de La Rumeur, pour n’en citer qu’un comme dans votre morceau "Banlieusards".
Kery James : Pour moi, c’est naturel. C’est comme ça que j’ai découvert le rap. Le rap n’est pas forcément militant. On ne peut dire : « Le rap, c’est ça ou que ça ! ». Dans les premiers morceaux de rap, il y avait aussi un côté très festif. C’était un Disc Jockey (DJ) qui branchait une sono dans un quartier. Des mecs (Master of ceremony ou MC) prenaient le micro et improvisaient une chanson, du genre : « Ok ! On va taper des mains comme ceci... » C’est une époque du rap que je n’ai pas connu. J’étais alors bien trop jeune. Mais, le rap peut aussi servir à porter la voix des sans-voix, de ceux qui souffrent et ma préférence va à ce rap-là. J’ai découvert le rap avec Public Ennemy et KRS-One, un rap avec des textes engagés et revendicatif. Ce sont de grosses influences pour mon côté voix et discours. Je préfère le sens, le fond à la forme. Pour moi être engagé, ça fait partie du rap. Je ne conçois pas faire de la musique autrement.
Dans le morceau : « 28 décembre 77 », vous parlez de votre naissance en Guadeloupe. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Kery James : Je suis né aux Abymes en Guadeloupe. Je suis arrivé en France en primaire. Je n’ai pas vraiment de souvenirs prononcés de ma période guadeloupéenne. Mes premiers souvenirs choquants de là-bas ? La fois où j’ai assisté à un tremblement de terre ! Sinon, c’était mes premières années d’insouciance. Je suis arrivé en France, en 1985, en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne (94). A ma descente d’avion, je me souviens encore le temps gris de Paris. Le dépaysement avec la Guadeloupe était total. C’était vraiment une autre atmosphère. Arrivé à Orly, on vivait dans des conditions matérielles et de promiscuité difficiles. Ma mère louait une pièce dans un pavillon. Dans cette petite pièce, il y avait mes deux grandes sœurs, moi et plus tard ma petite sœur.
Kery James chante "On n’est pas condamné à l’échec, voilà l’chant des combattants" © Arthur Delloye
Qu’évoquait la France pour vos parents ?
Kery James : C’est mon père qui a tenu à ce que nous venions en France. Comme beaucoup de Caribéens, il pensait que cela nous ouvrirait les portes d’une certaine réussite sociale. Venir en France, c’était avoir une chance de nous en sortir et de poursuivre des études poussées. J’ai même été envoyé en pension durant deux ans avant de revenir en école publique à Orly. Mes parents ont mis tous les moyens en leur possession pour que nous ne rencontrions aucun problème d’adaptation. Il s’agissait véritablement d’un sacrifice pour eux. L’éducation que j’ai reçue était rigoureuse. Ma mère était plutôt sévère avec nous. Mais, c’est ce qui a fait qu’aujourd’hui, j’ai pu m’en sortir. L’autorité parentale et mon éducation de base m’ont mis certains freins. A un moment pourtant, ma mère n’a pas pu me contrôler. Là où j’ai habité, si tu n’as pas d’adulte ou de parents derrière toi, tu peux sombrer très rapidement et très bas. Mon père n’avait pas maîtrisé, le fait qu’en France d’autres paramètres, d’autres tentations et d’autres problèmes sociaux autrement plus graves que là d’où nous venions.
On entend parfois que ce sont les parents qui défaillent dans les quartiers...
Kery James : Ce n’est pas aussi simple. Le problème est plus complexe et beaucoup d’éléments sont à prendre en considération. Bien sûr qu’il y a un manque de contrôle parental et qu’il peut y avoir un manque d’éducation. Dans ces quartiers, les parents vont tôt au travail et rentrent souvent tard. Ils multiplient les petits emplois, car la famille est souvent nombreuse. Ils travaillent jusqu’à dix heures par jour. En rentrant à la maison, ils sont fatigués. Ils oublient parfois de vérifier si leurs enfants ont fait leurs devoirs ou pas. Beaucoup n’ont pas le temps de faire un suivi quotidien de l’évolution des études de leurs enfants. En banlieue, les parents demandent aux enfants de devenir plus rapidement adulte qu’ailleurs. On nous demande très tôt de prendre conscience qu’on joue notre avenir, alors qu’en réalité, de 14 à 18 ans, tu ne te rends pas compte du temps qui passe. Tu n’as pas le sens des réalités et des responsabilités. Très peu de jeunes savent qu’en n’allant pas à l’école leur avenir peut être plombé. On ne peut pas déclarer de but en blanc : « C’est de la faute des parents ! » Il faut quand même que ces parents nourrissent leurs enfants. On ne devrait pas avoir à choisir entre instruire et nourrir ses enfants.
Vous êtes extrêmement calme et zen. Vous chantez la paix, toutefois énormément de mot liés à la guerre apparaissent dans vos textes.
Kery James : Je suis quelqu’un de calme puisqu’il n’y a pas de nécessité de rentrer dans une colère monstre. Lorsque je parle de combat, c’est une guerre contre les injustices et parfois contre nous-mêmes. On vit dans un monde qui est violent dans tous les sens du terme, notamment économiquement. Il faut ainsi avoir une certaine rage pour exister. Autrement, on se fait écraser. Le combat se fait dans des actes réels. Il n’y a donc pas la nécessité d’avoir tous les jours les sourcils froncés (rires).
Vous êtes issu d’un endroit avec beaucoup de nationalités différentes. Cela a-t-il joué dans votre manière de concevoir le monde ?
Kery James : Je pense. On a appris dans nos quartiers à vivre ensemble très tôt. Chez nous, il avait des Comoriens, des Haïtiens, des Antillais, des Maliens, des Français d’origine ou encore des Maghrébins. Assez vite, on a appris à se connaître et cohabiter.
« Pour ceux, Le Combat continue, Guerre, Incompris, Survivor... » Dans vos morceaux, on retrouve toujours cette volonté de lutte.
Kery James : Tout cela correspond à la réalité française aujourd’hui. C’est du moins ma réalité. Si je ne me bats pas, si je ne suis pas un « Survivor » ou si je ne crois pas que « Tout est possible » je finirais par baisser les bras et me faire écraser par le système. Même dans l’industrie de la musique, une industrie qui est en crise et où les choses vont mal, on est obligé d’être plus performants. On est dans une situation précaire et critique.
Est-ce un constat d’échec ?
Kery James : Nuance, c’est une situation qui voudrait nous mener à l’échec. Mais tant qu’on a de l’espoir, de l’envie de réussir les portes restent ouvertes.
D’où vous vient votre inspiration ?
Kery James : C’est un don de Dieu. J’aurais pu baisser les bras. Mais, on ne peut pas expliquer pourquoi telle personne dans sa vie va baisser les bras et décider de ne pas affronter les obstacles et une autre va prendre les difficultés comme moteur pour avancer dans son parcours de vie. Moi, j’ai un potentiel de résistance face aux difficultés que Dieu m’a fait endurer. J’essaie de le transmettre aux autres.
Comment vous définissez-vous dans cette diversité française ?
Kery James : Je suis et je resterai à jamais un enfant de la deuxième France, même si j’espère qu’un jour on puisse parler d’une France unifiée. Ce n’est pas que j’espère, en réalité c’est ce qu’on voudrait, mais il y a très peu de chances pour ça. Tous ce qu’on va donner aux enfants de la deuxième France ce sont des choses qu’on leur donnera parce qu’on ne pourra faire autrement. Tous ce qu’on va gagner ou tout ce qu’on a gagné jusque-là, tout ce qu’on a acquis, c’est grâce à notre persévérance est notre résistance. Sinon rien, dans tous les domaines, même entre nous, n’est donné. C’est, de toute façon, une règle de la vie.
Pourriez-vous me définir ce qu’est la deuxième France ? A-t-elle un rapport avec celle employée par Raffarin, l’ancien 1er ministre de Jacques Chirac : « La France d’en bas » ?
Kery James : Non, je disais cela bien avant que cette expression ne voit le jour avec Raffarin. Mais c’est peut-être ce qu’il a voulu dire. La deuxième France, pour moi, c’est le petit peuple, les prolétaires... Je parle des gens qui sont montrés du doigt, qui sont discriminés à cause de leurs origines, à cause de leur couleur et parfois à cause de leur seule situation sociale. Même pour une personne de type européen, qui vient de certains quartiers, c’est difficile de trouver un travail. Il existe dans ces quartiers une discrimination raciale, sociale et économique. Même si on est quand même en France et qu’il y a pire ailleurs. Mais, c’est quand même difficile pour les gens de se contenter de certaines choses quand d’autres vivent mieux qu’eux. C’est une des difficultés des jeunes de banlieue. C’est pour cette raison qu’avec la Fondation ACES, nous faisons faire voyager des jeunes des zones urbaines dans des pays où les conditions sociales, politiques et économiques sont plus difficiles. Cela peut-être salvateurs. La vraie difficulté est d’accepter que d’autres gens vivent à deux portes de chez toi, beaucoup mieux que toi. Mais, accepter qu’il y en a aussi loin de chez toi, qui vivent encore moins bien que toi.
Portraits issus du clip "Banlieusards" de Kery James © Arthur Delloye
Comment voyez-vous la France d’aujourd’hui ?
Kery James : La France comme tous les pays du monde est en danger parce qu’il y a des extrémistes de part et d’autres qui veulent empêcher les gens de vivre ensemble. La France n’échappe pas à la règle.
Quel est votre définition du vivre-ensemble ?
Kery James : Il ne doit pas y avoir qu’un seul modèle socio-culturel auquel tout le monde doit se conformer. Et quiconque sortirait de cet exemple de vie serait rejeté. Vivre-ensemble, c’est vivre avec sa différence, ses opinions et malgré ces différences, ces opinions, que l’ensemble d’une population parvienne à vivre en harmonie. C’est cela vivre ensemble à mon sens. Aujourd’hui en France, j’ai pourtant l’impression que pour beaucoup de gens, vivre-ensemble c’est : « Deviens comme ça et tout ira bien ! » Vouloir imposer à Autrui sa propre image et sa propre conception du monde et se fermer à l’Autre n’est acceptable. Quel marché équitable est-ce là ?
Vous aviez d’ailleurs sorti un album qui s’appelait « Savoir et vivre ensemble ». Pourquoi ce projet ?
Kery James : Je suis musulman et converti à l’Islam depuis plusieurs années et après les événements du 11 septembre 2001 et les autres attentats ignobles qui ont été commis par des extrémistes qui se réclament de l’Islam, j’ai eu l’impression que certains médias profitaient de ces actes pour jeter l’opprobre et faire l’amalgame entre les fanatiques et le simple musulman. J’ai eu l’idée de faire un disque dans lequel je rappelle que des valeurs universelles telles que le respect, la bienfaisance, la générosité et la modestie sont aussi partagées et défendues par l’Islam. Dans ce projet, il y avait des gens de confessions et d’origines différentes. Il y a des gens censés qui reconnaissent des valeurs qui sont incontestables pour n’importe quelle personne qui a une raison et qui l’utilise correctement.
Pourquoi vous êtes-vous orienté vers l’Islam et non vers une autre religion par exemple ?
Kery James : Déjà par conséquences historiques et sociales. C’est-à-dire que j’ai grandi dans un quartier essentiellement peuplé d’Africains du Nord et du Sud dont la religion prédominante était l’Islam. Quand pendant un moment j’avais coupé court avec la spiritualité et que j’ai eu besoin de nouveau d’une spiritualité, la première personne que j’ai rencontrée n’était pas bouddhiste ou d’une autre confession. Autour de moi, il n’y avait que des musulmans. C’était plus facile de m’intéresser à cette religion-là. C’est la première raison. La seconde étant que l’Islam m’a toujours intéressé. En allant plus loin dans mon apprentissage de cette religion, j’ai trouvé une hygiène de vie qui correspondait mieux à mon âme.
Vous avez depuis toujours, bien avant même votre conversion, eu une orientation très mystique qui rappelle d’autres rappeurs comme Akhenaton des Imperial Afro-asiatic Men (IAM), Abd-Al Malik des New Africain Poètes (NAP), d’Ali, ex-Lunatic, ou encore de MC Solaar. D’où cela vous vient-il ?
Kery James : Depuis longtemps, j’ai baigné dans une éducation religieuse. A titre personnel, c’est la spiritualité qui devrait régir toute ma vie. La croyance en l’existence de Dieu, je l’ai toujours exprimée dans mes textes. C’est aussi parce que j’aime beaucoup les mots et j’aime que les phrases soient belles et bien tournées.
Vous êtes un membre historique de la Mafia Cainfry, une équipe multi-ethnique et multi-culturelle de copains issus des mêmes quartiers. Pourquoi ce nom ?
Kery James : C’est un nom qu’on choisit en 1997, à une époque où on menait une vie qui était entre bizness, illicite et musique ; et quand on s’est appelé « Mafia Cainfry » c’était un nom qu’on voulait assumer. Un nom qui représentait notre mode de vie à l’époque. Et il vrai que dans la Mafia Cainfry, il y a des gens de toutes les origines et de toutes les couleurs. D’ailleurs, c’est quelque chose qui est propre aux quartiers. Trop souvent dans les médias, on nous parle de problème de religions, de communautarismes et de cultures. Mais, dans les quartiers la diversité et le vivre ensemble on l’expérimente pour de vrai et depuis bien longtemps. Cela fait longtemps qu’on a dépassé ce stade même si à certaines époques il y a eu des tensions et des crispations entre les Arabes et les Noirs, entre les Antillais et les Africains, on ne peut pas le nier, mais c’est des choses qui ont été dépassés depuis longtemps. Dans les quartiers, on sait vivre ensemble.
Comment voyez-vous les relations entre Antillais et Haïtiens ?
Kery James : Entre Haïtiens et Antillais, en Guadeloupe, je ne me souviens pas. Certains Antillais ont toujours fait une distinction entre les Haïtiens et eux. De toute façon, je n’ai pas l’impression que la mentalité connue des Haïtiens soit la même que celles des Antillais. J’ai vraiment l’impression que les Haïtiens sont plus proches de l’Afrique que certains Antillais. Maintenant, c’est toujours difficile de répondre de manière définitive à ce genre de questions. On ne peut généraliser cette règle, car il y a plein d’Antillais et d’Haïtiens qui ne sont pas concernés. J’ai pu observer un racisme des Antillais envers les Haïtiens et des Haïtiens envers les Antillais. Ce racisme, je l’observe plus encore entre les Antillais et les Africains. Dans le quartier à l’époque, il y avait parfois des affrontements entre Antillais et Africains noirs. Je ne sais pas vraiment à quoi cela était dû. Mais, c’est regrettable. Il y a toujours deux à trois éléments dans un groupe qui sortent du lot et pas forcément pour les bonnes raisons. Ils donnent une image négative de cette cohabitation qui, dans l’ensemble, était positive et sincère. Mais encore une fois, des cons il y en a partout.
Kery James © Arthur Delloye
Qu’évoque pour vous l’Afrique ?
Kery James : Respect, grand respect... Je n’ai pas besoin d’en dire davantage.
Votre rêve est-il américain, français ou africain ?
Kery James : J’aime bien le rêve africain. Car dans ce rêve-là, selon moi, il y a du partage. Beaucoup de personnes viennent en France en provenance d’Afrique. La moitié de leur économie passe dans l’aide au développement et à la famille élargie restée au pays. Je suis davantage attiré par le rêve africain qu’américain qui dans mon esprit résonne comme un capitalisme sans vergogne où il la réussite passe par l’écrasement de l’autre.
Est-ce pour ces raisons que vous développé ces valeurs de solidarité dans votre fondation ACES (Appendre, Comprendre, Entreprendre et Servir) ?
Kery James : Cette action est la concrétisation de ce que je prétends dans mes textes depuis un certain moment. Depuis 2001, j’écris des morceaux comme « Relève la tête ». J’ai dit des choses comme « je veux que les jeunes Africains relève la tête, que leur parcours scolaire ne soit pas signe de défaite, que la France voit naître une génération d’ingénieurs, qui ne soit pas que footballeurs, acteurs ou chanteurs ». C’est une chose de le dire, c’en est une autre de faire de ces paroles une réalité. C’est un de mes buts.
A terme, on va finir par vous voir sur le terrain politique.
Kery James : Après, ça dépend de la définition qu’on a de la politique. Si ça consiste à se réclamer de gauche ou de droite et de viser le pouvoir, alors non, je ne fais pas de politique. Si ça consiste à faire avancer la vie de la Cité, dans ce sens-là, pourquoi pas ! Alors oui, je fais de la politique. J’essaie d’utiliser mon art pour faire passer un message, mais j’aime l’art avant tout pour ce qu’il est.
Qu’évoque pour vous Haïti, le pays de vos parents ?
Kery James : La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à Haïti, c’est le mot révolution.
Haïti subit une grave crise politique, économique et sociale. Comment vivez-vous cela ?
Kery James : C’est forcément difficile. Malheureusement concernant les tenants et les aboutissants véritables de la crise, je ne connais pas suffisamment la profondeur et la complexité du problème, même si bien entendu j’entends, autour de moi, des choses ici et là, pour émettre un jugement judicieux. Il m’est très difficile de porter un regard mûr et distancié. Concernant la crise économique, il n’est pas étonnant pour un pays qui a arraché son indépendance de subir un contre-coup. C’est un des prix à payer pour la liberté.
Votre précédent album s’appelait « Ma vérité ». Quelle votre vérité du moment ?
Kery James : Ma vérité personnelle du moment est assez complexe. Je suis tiraillé entre deux moi. Une partie de moi est calme et posée. Une autre partie de moi est plus énervée, plus revendicatrice, plus rebelle, plus révoltée, moins patiente. C’est ma dualité.
Un de vos moi, le plus révolté, a défrayé la chronique médiatique avec l’affaire Jean Gabin. Où en est l’histoire ?
Kery James : Vous avez le droit d’en parler aussi. Ce que je peux dire c’est que c’est une affaire qui est en train de se régler. Et j’espère qu’on va trouver un terrain d’entente pour qu’on puisse chacun faire de la musique et se consacrer à l’art plutôt qu’aux faits divers.
Un rêve ?
Kery James : Etre plus droit, plus pieux (...) Pour les gens qui veulent aider à donner des cours de soutien, ils peuvent s’adresser à l’adresse suivante : acesbenev@yahoo.fr. Pour les jeunes qui voudraient bénéficier de ce soutien scolaire peut écrire à : acesespoir@yahoo.fr
- 15/02/2008, 21h03 #2

Dernière modification par miss ében 15/02/2008 à 22h10
Personne ne peut passer une chaîne à la cheville de son compagnon humain sans finir pas se nouer l'autre bout autour du cou.
Frederick Douglass
- 15/02/2008, 23h52 #3

Pour moi ce mec est le meilleur rappeur français!! Depuis Ideal J il me donnait des frissons quand j ecoutais "un nuage de fumée", "hardcord" ou "J ai mal o coeur" et il a continué avec tous ses albums. Son prochain album est attendu je suis sur que ça sera une tuerie!!!
Y a pas de degré d inclinaison de mon corps, l inclinaison de ma tete est une reponse directe à l inclinaison de mon coeur!
- 16/02/2008, 09h05 #4Junior Member

- Date d'inscription
- février 2008
- Messages
- 13

je suis tout a fai d'accord avec vous! c'est vraiment le meilleur rappeur français! quand il rappe sa fait "tres mal tres mal tres mal"
Un de mes titres favoris est "les frères ne savent pas"
- 16/02/2008, 20h24 #5

Je kiffe sa façon de rapper Il dit des choses justes Comme une de ses chanson : Banlieusard
La vie n'est que poussière, le vrai avenir c'est ce qui nous attend dans l'au delà.
- 17/02/2008, 08h42 #6

J'ai hâte d'écouter son nouvelle album !! Pour moi c'est l'un des meilleurs rappeurs en France. Les textes de Banlieusards font vraiment réfléchir, ainsi que tous ces textes. Et humainement ça se voit qu'il a la tête sur les épaules !
Un peuple, un but, une foi
- 17/02/2008, 13h07 #7
 A.L.I.X originaire des terres d'Afrique
A.L.I.X originaire des terres d'Afrique
Trop fort ce mec il a tout compris à la vie ! Ses textes sont très réfléchis et pertinents. Depuis l'époque Idéal J j'achète tout les albums qu'il sort donc c'est avec beaucoup d'impatience que j'attends le prochain.
Merci à la personne qui a publié cette interview.
"Le Combat continue"Ma vie est tristement belle...
- 17/02/2008, 16h12 #8

ca c est un rappeur et son dernier album a l air tres fort
apres le boucan c est le vacarme
- 17/02/2008, 16h47 #9Senior Member

- Date d'inscription
- novembre 2006
- Messages
- 404

Pour moi c'est tout simplment le meilleur! bonne continuation à lui!
Sache que ta jalousie n'est que motivation pour ma personne!
- 17/02/2008, 18h47 #10

Oui, l'intérêt de son rap c'est qu'il donne à chacune de ses chansons un sens, à travers les paroles et messages qu'il souhaite faire passer.
C'est pas lui qu'on entendrait chanter "éh les keufs et les meufs dans le RER...."Il ne suffit pas d'observer et de décrire le monde, mais il faut le transformer par l'activité humaine. [massa makan diabate]
Discussions similaires
-
James WATSON : les Africains seraient-ils moins intelligents que les blancs?
By assetou in forum Actualités, Coupures de PresseRéponses: 3Dernier message: 23/10/2007, 14h29 -
James Brown : Mort du Roi de la Soul.
By Jade in forum USARéponses: 0Dernier message: 26/12/2006, 09h37


 LinkBack URL
LinkBack URL À propos de LinkBacks
À propos de LinkBacks




 Réponse avec citation
Réponse avec citation
