Sources: Le Monde du 28 mars 2009 article de Michel DelbergheAu sortir de la barge qui relie Mamoudzou, la ville principale, à l'île de Petite-Terre, comme dans la rue du Commerce où les taxis slaloment entre les nids de poule, aucun signe ne laisse deviner que Mayotte s'apprête à vivre un événement historique.
L'issue semble fixée d'avance. Au soir de la consultation référendaire, dimanche 29 mars, cet archipel de 374 km2, entre le Mozambique et Madagascar, français depuis 1841 et peuplé de 186 452 habitants, pour la quasi totalité musulmans, devrait devenir le 101e département français, selon l'engagement du président de la République, Nicolas Sarkozy. Il sera le cinquième en Outre-mer avec la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
Telle qu'elle figure dans le document officiel, en français et en arabe, la question de la "transformation de Mayotte en collectivité unique, régie par l'article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux régions", est complexe, tant l'écart est considérable entre le plus africain des territoires d'Outre-mer et l'Hexagone.
La réponse s'annonce beaucoup plus simple. Tous les partis politiques, de droite et de gauche - y compris le Parti communiste local, en contradiction avec ses dirigeants nationaux -, mais aussi les syndicats et les patrons font cause commune pour le "oui". Seules des rumeurs laissent entendre que des consignes de refus circuleraient dans certaines mosquées "fondamentalistes", tandis que les "m'zungus", les métros, qui se tiennent à l'écart de la campagne, pourraient manifester leur désaccord. Le député (MoDem) Abdoulatifou Aly, partisan lui aussi d'un "département 100 % français", a fait campagne en solitaire.
Ce n'est pas la première fois que les Mahorais se prononcent. A trois reprises, ils ont proclamé leur attachement à la France. En 1974, ils ont refusé, à 66 %, la voie de l'indépendance avec les Comores. Deux ans plus tard, ils l'ont à nouveau rejetée, à 99,4 %. En 2000, ils ont accepté à 73 % le statut spécial proposé par le gouvernement de Lionel Jospin, qui préfigurait la création d'un département.
"C'est d'abord l'aboutissement d'une promesse de 50 ans", assure Mansour Kamardine, ancien député (UMP). Le président (UMP) du conseil général, Ahmed Attoumani Douchina invoque, lui, "la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes". Au PS, Ibrahim Aboubacar, conseiller général, confirme cette unité "qui ne signifie pas une adhésion au gouvernement". En réalité, relève l'écrivain Nassur Attoumani, "plus qu'une affirmation de l'ancrage avec la France, c'est un choix délibéré de se séparer définitivement des Comores". La République islamique voisine continue de revendiquer la souveraineté sur l'archipel. "Quand on voit la situation des Etats à proximité, les Mahorais ne sont pas prêts de les rejoindre", tranche M. Attoumani.
Les contours du nouveau département demeurent extrêmement flous, et tout reste à construire. "On ne sera pas à l'abri de fortes tensions", reconnaît le syndicaliste Saïd Boinali (CFDT).
L'avenir du processus est lié au sort des quelque 60 000 clandestins anjouanais, comoriens et depuis peu africains des Grands lacs, qui continuent d'affluer sur les côtes. En 2008, 16 000 d'entre eux ont été renvoyés par la police selon des procédures expéditives, dont 6 000 avaient été interceptés dans les "kwassa-kwassa". Ces embarcations de fortune sont utilisées pour franchir dans des conditions de sécurité hasardeuses les 70 km du bras de mer qui sépare Anjouan de Mayotte. Au prix de salaires de misère et d'un habitat de fortune, les clandestins participent à l'économie souterraine, en contrepartie d'un accès à l'éducation et à la santé.
La départementalisation ne sera effective qu'en 2011, à la date du renouvellement de l'assemblée. D'ici à la fin de l'année, une loi organique devrait confirmer le résultat du référendum, puis une loi ordinaire fixera les modalités du nouveau conseil, le nombre d'élus et leur mode d'élection.
Depuis 2000, l'Etat a commencé, non sans difficultés, à rapprocher le droit local et ancestral du droit commun, national. La polygamie est désormais interdite et de nouvelles règles du mariage, de la famille et des successions vont être instaurées. La révision de l'Etat civil est en cours, mais avant la mise en place d'une fiscalité locale, dès 2014, il faudra élaborer le cadastre et définir des titres de propriétés inexistants. La Sécurité sociale n'est en place que depuis 2004 et les allocations familiales depuis 2002. L'application des minima et des droits sociaux, comme l'attribution des allocations, devraient se faire à partir de 2012.
Les Mahorais comptent sur la "solidarité nationale" et attendent de l'Etat un effort considérable de rattrapage en équipements et en infrastructures, pour le logement, la santé, l'éducation et le développement économique. Yves Jégo, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, l'a chiffré à 200 millions d'euros par an pour atteindre l'échéance de l'intégration d'ici 20 ans ou 25 ans. Le temps d'une génération.
La départementalisation de Mayotte va entraîner la fin de la justice cadiale, ou tout du moins la justice ne pourra plus être rendue sur la base du code coranique ce qui implique notamment que les filles ne pourront plus se marier dès 15 ans mais seulement à partir de 18 ans (comme le prévoit le code civil) et que les mariages polygames seront désormais interdits (les mariages polygames déjà célèbrés demeurant valables biensûr rassurez-vous!).
Wa Salam.
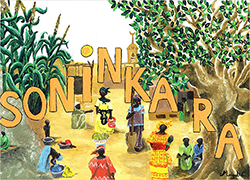
Affichage des résultats 1 à 10 sur 51
Discussion: Fin de la polygamie à Moyotte...
Threaded View
- 28/03/2009, 05h07 #1
 Fin de la polygamie à Moyotte...
Fin de la polygamie à Moyotte...
Discussions similaires
-
Face à la polygamie
By djedji in forum Unions, Mariages, Moeurs, ...Réponses: 394Dernier message: 01/07/2013, 10h01 -
La polygamie en France.
By Diouma in forum Unions, Mariages, Moeurs, ...Réponses: 93Dernier message: 01/10/2010, 19h39 -
conseil polygamie
By ourthi fillah in forum Unions, Mariages, Moeurs, ...Réponses: 5Dernier message: 17/08/2008, 12h10 -
Polygamie et fidélité
By rohkiya in forum Unions, Mariages, Moeurs, ...Réponses: 64Dernier message: 02/02/2008, 16h34


 LinkBack URL
LinkBack URL À propos de LinkBacks
À propos de LinkBacks





 Réponse avec citation
Réponse avec citation