De la prison ferme a été requise, vendredi à Bobigny, contre Aïssata et Mamadou S. accusés d’esclavage domestique durant neuf ans à l’égard de « Rose », une jeune Malienne:
Elle est arrivée dans la 15e chambre correctionnelle du tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) avec son écharpe sur la tête. Pour tenter de cacher son visage des caméras et des appareils photos des journalistes qui l’attendaient. Son nom aussi, elle le cache. Depuis quelques jours, les médias l’appellent « Rose ». Cette Malienne de 23 ans aurait été l’esclave domestique d’un couple franco-malien pendant neuf ans, de 1997 à 2006. Aïssata et Mamadou S. comparaissaient vendredi pour soumission d’une mineure à des conditions de travail indignes.
Rose est née « dans un petit village loin de Bamako, raconte-t-elle à l’audience. Je suis née pauvre, mais j’étais contente de cette vie. » Après le décès de son père, Rose part vivre quelque temps chez un cousin de sa mère, à Bamako. C’est là qu’elle rencontre Aïssata S. « Tu vas garder mes enfants », lui aurait-elle dit. Aïssata S. rentre en France avec Rose en 1997, à l’aide de faux papiers. Quand elle s’installe dans le pavillon de Bondy, en Seine-Saint-Denis, où vivent Aïssata, employée de mairie, son mari Mamadou, chauffeur de taxi, et leurs quatre garçons, Rose a 11 ans. Et « pas vraiment un emploi du temps de petite fille », souligne le président du tribunal. « Je me levais à 7 heures et me couchais à 22 heures, détaille la jeune femme pendant l’audience. Je faisais le ménage, le repassage, je m’occupais des enfants, je les accompagnais à l’école, je faisais le repas, je lavais la voiture… »
Appelée à la barre, Aïssata S. tente de se défendre : « Comme toute fille africaine, elle faisait le ménage. » Rose reprend : « Tout ce que j’avais, c’est madame S. qui me l’achetait. Elle ne me donnait pas du tout d’argent. » Pour l’avocat d’Aïssata S., Me Abdelhakim Bekel, Rose n’a été « ni séquestrée, ni brimée, ni cloîtrée. Elle avait des amis, elle vivait intégrée dans la communauté malienne. Elle a participé aux bons et mauvais jours de la famille ».
« Démolie ». Le français, Rose dit l’avoir appris « par la télévision ». Elle n’est pas allée à l’école pendant les neuf années au service du couple. Le président du tribunal insiste : pourquoi Rose n’était-elle pas scolarisée ? « Pour l’inscrire à l’école, on me demandait une autorisation parentale et des papiers du Mali, et je ne les avais pas », se défend Madame Aïssata. Rose n’avait pas le droit de « parler aux gens » parce qu’elle n’avait pas de papiers et qu’elle allait « avoir des problèmes ». Elle n’avait plus le droit de manger à la table de la famille parce qu’elle « sentait l’eau de Javel ». Pour Rose, ce sont neuf années de « maltraitance et d’humiliations ». « Aïssata me disait : "Ma fille, moi je fais de toi ce que je veux. Pour la France, tu n’existes pas, tu n’as pas de papiers." Elle m’insultait, elle me giflait, elle me crachait dessus, et me disait que je ne valais rien. »
Pendant l’audience, Aïssata S. s’est dite « surprise » d’apprendre que la jeune fille était « malheureuse » : « On sortait, il y avait des éclats de rire. On allait au resto et on faisait nos courses ensemble. » Pour Anick Fougeroux, vice-présidente de l’association SOS Esclaves et avocate de Rose, « les esclaves domestiques sont transparents. C’est un vrai traumatisme ». Elle estime que Rose a été « démolie, très abîmée. On lui a volé son enfance, son adolescence, ses premiers émois de jeune fille ».
En 2006, Rose raconte son histoire à une voisine, qui la dirige vers des associations, dont le Comité contre l’esclavage moderne. Elle porte plainte. Les deux époux sont placés en garde à vue pendant quarante-huit heures, puis libérés. Devant le tribunal, ils nient. Selon Me Bekel, Rose aurait porté plainte pour être régularisée : « Elle a été instrumentalisée de bout en bout par le Comité qui a monté tout son dossier. Tout ce qu’elle veut, c’est avoir des papiers. »
Fleuriste. Rose quitte le foyer des S. en 2006, un sac-poubelle avec quelques affaires sous le bras. Aujourd’hui, elle prépare un CAP de fleuriste et vit dans un foyer de jeunes travailleurs à Suresnes (Hauts-de-Seine). Elle a obtenu une carte de séjour temporaire et a engagé une procédure auprès des prud’hommes de Bobigny contre les époux S., pour réclamer neuf ans de salaires. La procureure a requis deux ans de prison, dont seize mois avec sursis, contre Aïssata S. A l’encontre de son époux, considéré comme « effacé et dominé par sa femme », quatorze mois, dont douze avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 6 novembre.
Par ISABELLE HANNE
Source : Liberation.fr
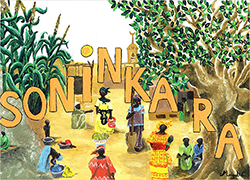
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5
Threaded View
- 18/10/2009, 15h43 #1
 Vrai ou faux : A Bondy,une malienne avait sa bonne à tout faire venue du pays
FB : bakelinfo departement de Bakel
Vrai ou faux : A Bondy,une malienne avait sa bonne à tout faire venue du pays
FB : bakelinfo departement de Bakel
Discussions similaires
-
Tout le monde veut sa part de (faux) halal
By Salem in forum ReligionRéponses: 1Dernier message: 11/02/2010, 23h39 -
Les faux résultats des fausses éléctions en Mauritanie!
By Cheikhna Mouhamed WAGUE in forum MauritanieRéponses: 12Dernier message: 11/08/2009, 22h36 -
Une pure hypocrisie, et si son fils n'avait pas joué dans ce film ?
By makalou in forum Actualités, Coupures de PresseRéponses: 6Dernier message: 01/06/2008, 20h29 -
diongomaw : nouvelle venue !
By diongomaw in forum Nouveaux membres, Présentez-vousRéponses: 21Dernier message: 21/05/2008, 11h23 -
Cho Seung-hui, le tueur de Virginia Tech, avait envoyé un colis à la chaîne NBC
By Fodyé Cissé in forum Actualités, Coupures de PresseRéponses: 9Dernier message: 24/04/2007, 03h58


 LinkBack URL
LinkBack URL À propos de LinkBacks
À propos de LinkBacks





 Réponse avec citation
Réponse avec citation